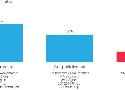685 liens privés
Dans le monde occidental, des millions de personnes quittent leur travail. L’offensive néolibérale, la catastrophe écologique et la pandémie ont attisé cette fugue massive. Enquête [1/3]
Vous lisez le premier volet de notre enquête « La grande démission ». Le second volet se trouve ici et le troisième là.
L’appel à déserter lancé le 10 mai par les étudiants d’AgroParisTech a agi comme un détonateur. Visionnée plus de 12 millions de fois, leur vidéo a libéré la parole et révélé un mouvement de fond qui remet en cause frontalement les modèles de la réussite sociale. C’est une fissure dans l’ordre établi : la carrière ne fait plus rêver. Les tours de la Défense et la « rolex à cinquante ans » non plus. Partout, des jeunes et des moins jeunes questionnent le travail, sa finalité et son sens. Certains, même, le refusent, pour inventer, ailleurs, une vie qu’ils et elles estiment plus riche.
Quelques mois seulement après le glas des confinements, qui a gelé tout un pan des activités économiques, une partie de la population rechigne toujours à revenir dans le rang, à finir ses études, ou à retourner dans les usines ou les entreprises. Aux États-Unis, des sociologues ont baptisé ce phénomène « Great Resignation » ou « Big Quit » : « la grande démission ». En 2021, plus de 38 millions d’étasuniens ont quitté leur emploi. 40 % n’ont toujours pas repris de travail. Un tsunami qui touche tous les âges, tous les métiers. Et qui renverse le rapport de force entre salariés et entreprises.
De plus en plus de personnes cherchent une sortie d’urgence au monde du travail. Unsplash / Possessed Photography
« Nous démissionnons tous, désolés pour le dérangement », écrivent sur une affiche les salariés d’un Burger King dans le Nebraska. « Veuillez être patient avec le personnel qui a répondu présent, plus personne ne veut travailler », disent les employés d’un McDo au Texas. « Fuck les cadres, fuck cette entreprise, fuck ce job… Je démissionne, putain ! », crie dans le haut-parleur de son magasin une employée de Walmart au Texas. Un discours qui fit des émules parmi ses collègues.
L’Amérique bouge et elle n’est pas la seule. En Angleterre, les seniors démissionnent en masse. 300 000 travailleurs âgés de 50 à 65 ans ont rejoint la catégorie des « économiquement inactifs ». Leur désir principal, selon le résultat d’une vaste étude ? Prendre leur retraite et s’échapper définitivement du monde professionnel.
Au Québec, la tension est telle que les employeurs ne renâclent plus à embaucher des mineurs pour faire face à la pénurie de travailleurs dans les secteurs de la manutention et des services. 240 000 postes restent abandonnés. En Espagne, on imagine même faire venir des milliers de Marocains et prolonger les cartes de séjour des étrangers pour pallier le manque de main d’œuvre dans le secteur du tourisme.
À quoi bon s’élever quand tout s’écroule ?
Cette situation résonne avec la France. Ici aussi, l’exode a commencé. Des centaines de milliers de postes ne sont pas pourvus, faute de candidats, dans l’hôtellerie ou la restauration tandis que dans les grandes écoles, chez les classes moyennes supérieures, la sécession couve. Au-delà des discours tonitruants dans la presse, une révolte plus silencieuse se propage. Dans chaque promotion, et même là où on l’attend le moins, dans les entreprises des énergies fossiles ou dans la haute administration publique.
Le doute se répand. La crise écologique vient battre en brèche les rêves d’antan au goût de naphtaline. Que vaut une promotion face au péril climatique ? Pourquoi se battre pour des places quand c’est tout le système qui vacille ? À quoi bon s’élever quand tout s’écroule ?
Une « menace pour l’économie française » D’après un récent sondage, publié en mai, plus d’un tiers des sondés (35 %) affirme n’avoir jamais eu autant envie de démissionner. Une proportion qui monte à 42 % chez les moins de 35 ans. Les observateurs parlent de « révolution sociétale », et de « menace pour l’économie française ».
En bas de l’échelle, l’offensive néolibérale pousse aussi au départ. Face aux dégradations des conditions de travail et aux bas salaires, nombreux sont les employés, écœurés, à prendre la poudre d’escampette. À l’hôpital, le phénomène est particulièrement visible. Les cadences et le manque de reconnaissance incitent les aides soignants et les infirmières à partir. 60 000 postes ne trouvent toujours pas preneurs.
Le 14 février 2020, à Paris. © Mathieu Génon / Reporterre
La pandémie a joué un rôle catalyseur. Elle a frappé les esprits. Le confinement a mis à l’arrêt la machine dont on ne trouvait pas le frein d’urgence. En suspendant, un temps, le fonctionnement dont nous étions tous les otages, le virus a révélé l’aberration de la « normalité », estiment les auteurs d’un puissant texte paru en mars 2020 sur le site Lundimatin : « Ce qui s’ouvre devant vous, ce n’est pas un espace délimité, c’est une immense béance. Le virus vous désœuvre. […] Il vous place au pied de la bifurcation qui structurait tacitement vos existences : l’économie ou la vie. C’est à vous de jouer. L’enjeu est historique. »
À quoi tient-on vraiment ? Alors que le monde bascule, des choix décisifs s’offrent à nous. Ils résonnent comme autant de petites voix intérieures. Il est temps d’habiter sa propre vie, de ne plus se renier, de sortir de la dissonance. « Il faut chercher la force de dire non », écrivait Albert Camus dans L’homme révolté.
Chemins de traverse
À tâtons, des chemins de traverse se dessinent pour lutter contre ce que David Graeber appelait « les bullshit jobs ». De nombreuses personnes décident de faire un pas de côté. En France, ils et elles profitent du chômage et du RSA pour se reconvertir, voyager ou simplement sortir du salariat. Reporterre en a rencontré des dizaines, tous et toutes en quête de sens. Certains et certaines, même s’ils restent évidemment minoritaires, deviennent paysans, d’autres revalorisent l’artisanat et les métiers manuels, d’autres encore s’investissent dans des luttes.
« Je n’ai plus envie de participer à cette mascarade », confie ainsi Noémie, une ancienne consultante de 30 ans devenue éleveuse de porcs en agriculture biologique. « Je ne veux plus mettre ma force de travail au service de job destructeurs », poursuit Pierre, un ex-élève ingénieur qui sillonne désormais les zad. « Je ne retournerai pas bosser pour un patron, soixante heures par semaine pour une paie de misère », ajoute Claire, ancienne restauratrice parisienne maintenant installée dans la Drôme. Élodie, elle, était infirmière à Toulouse mais a préféré quitter le navire. « L’hôpital se transforme en usine de soins. On vit une forme de maltraitance sociale », raconte-t-elle. Son nouveau projet ? Une ambulance autogérée et nomade qui parcourrait la France, les lieux de lutte et les quartiers populaires.
« On arrête tout, on réfléchit et ce n’est pas triste » On mesure encore mal le séisme qui vient. Mais il flotte dans l’air un parfum de L’An 01, ce film de Jacques Doillon, emblématique de la contestation libertaire des années 1970, au slogan éloquent : « On arrête tout, on réfléchit et ce n’est pas triste. »
Les récentes statistiques du ministère du Travail le confirment : la vague n’est pas près de s’arrêter. On a enregistré 1,6 million de démissions de CDI en 2021. Aux troisième et quatrième trimestres, la barre des 500 000 démissions a été dépassée. C’est arrivé une seule fois sur les vingt dernières années, en 2008, et c’est le double des chiffres de 2015.
Un panneau indique « On embauche » devant une entreprise en Amérique du Nord. Unsplash / Ernie Journeys
Mais, plus encore que ces données, c’est la bulle médiatique qui détonne. « L’écho qu’ont pu avoir les appels à la désertion en dit long sur les questionnements qui agitent la société, souligne la sociologue Geneviève Pruvost. Aujourd’hui la désertion vient toucher des professions indispensables au fonctionnement du modèle capitaliste. Elle met en péril la pérennité du système », ajoute-t-elle.
« Si cent ingénieurs ou chercheurs du milieu toulousain décidaient d’arrêter de faire des algorithmes et des robots, ça casserait tout », confirme Olivier Lefebvre. Ce quadragénaire a lui-même déserté son poste. Il travaillait dans une start-up sur les voitures autonomes avant de tout envoyer valser.
Les rouages se rebiffent
Alors qu’ils sont les rouages de la machine techno-industrielle, les ingénieurs sont de plus en plus nombreux à se rebiffer. Arthur Gosset, l’ex étudiant de centrale Nantes qui a réalisé le film Rupture(s) — dans lequel il évoque la bifurcation de ses camarades déserteurs — estime qu’ils représentent environ 30 % des promotions. Un chiffre difficilement vérifiable tant les études quantitatives sur le sujet manquent. Les grandes écoles et les associations d’anciens élèves n’ont pas forcément intérêt à communiquer sur cette fuite généralisée.
« Notre discours sur le refus du travail est aujourd’hui beaucoup plus audible », constate néanmoins Romain Boucher. Cet ancien data scientist diplômé de l’École des mines a quitté son métier en 2018. Dans son bureau à proximité des Champs-Élysées, les assauts des Gilets jaunes furent « l’onde sismique » qui l’incita à rompre avec son monde.
« On veut corroder cette classe sociale qui tient le système » Il a depuis créé l’association Vous n’êtes pas seul pour inciter ses ex-collègues à démissionner. « En subvertissant la petite bourgeoisie managériale et diplômée, nous entendons enrayer la courroie de transmission qu’elle incarne. On veut corroder cette classe sociale qui tient le système », dit-il.
La désertion sape les soubassements idéologiques de l’économie, elle brise son adhésion et écaille son vernis teinté de vert. L’écrivaine Corinne Morel Darleux y voit même « une forme de sabotage symbolique ». « Le refus de parvenir est aujourd’hui susceptible de s’inscrire dans la longue lignée de l’action directe et de la non-coopération au système, écrit-elle dans son essai Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. La désertion est une arme redoutable qui libère l’avenir. »
L’insuffisance professionnelle, les 4 règles à savoir.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi. Elle ne se confond pas nécessairement avec une insuffisance de résultats, et doit être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire.- L’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive.
Par définition, seul un comportement volontaire du salarié est susceptible d’être qualifié de faute. L’insuffisance professionnelle résulte, elle, d’un comportement involontaire du salarié. Par conséquent, elle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
Si l’employeur choisit néanmoins cette voie, en l’absence de fait caractérisant ne serait-ce qu’une faute ordinaire, le licenciement se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important la cause de l’insuffisance qu’il avance.
Rappelons toutefois que l’employeur est en droit de reprocher au salarié à la fois son insuffisance professionnelle et un motif disciplinaire.
Par ailleurs, si l’insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, la jurisprudence admet qu’il en va différemment lorsque cette insuffisance résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié. En effet, dans ce cas-là, l’employeur aura la possibilité de prononcer un licenciement pour faute à l’encontre du salarié, ce dernier ayant fait preuve d’une négligence fautive (Cass. soc. 23-6-2010 n° 09-40.073).
Si le principe édicté par la jurisprudence semble clair, la réalité ne l’est pas toujours et il n’est pas toujours aisé de distinguer la frontière entre l’insuffisance professionnelle et la négligence fautive, entre l’erreur révélatrice de l’incompétence du salarié et celle caractérisant un manquement fautif de sa part.
- L’insuffisance professionnelle n’est pas forcément une insuffisance de résultat.
L’insuffisance professionnelle d’un salarié peut se traduire par un manque de résultats, en particulier lorsque l’intéressé a convenu avec l’employeur d’objectifs chiffrés.
Toutefois, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats ne recoupent pas nécessairement les mêmes réalités. Il peut y avoir insuffisance professionnelle si le salarié n’exerce pas ses fonctions de manière satisfaisante, sans que cette carence ne se traduise nécessairement par de mauvais résultats.
De même, un salarié peut ne pas atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par l’employeur sans pour autant avoir manifesté une quelconque insuffisance dans ses fonctions.
La notion d’activité insuffisante ne se confond pas avec l’insuffisance des résultats qui peut exister même lorsque le salarié manifeste une activité professionnelle conforme à celle imposée par l’employeur.
- L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs.
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur. Mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Le juge va vérifier que l’évaluation faite par l’employeur s’inscrit dans une gestion du personnel cohérente et que le salarié a montré des insuffisances dans un poste qui correspondait à ses qualifications.
Confronté à un problème d’insuffisance professionnelle, l’employeur n’a en principe pas d’obligation de proposer au salarié concerné un poste de travail plus adapté à ses capacités, alors même qu’il en aurait la possibilité compte tenu des postes disponibles dans l’entreprise.
Toutefois, certaines dispositions conventionnelles peuvent limiter le droit de résiliation unilatérale de l’employeur en lui imposant une obligation de reclassement interne comme préalable au licenciement.
- L’insuffisance professionnelle se qualifié au regard de l’obligation d’adaptation de chaque employeur.
Conformément à l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Il doit donc proposer à ses salariés les actions de formation nécessaires, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correct leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions.
Un employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
Tel n’est pas le cas lorsque l’employeur n’a pas mis en place la formation spécifique et l’accompagnement suffisants qu’exigeait l’exécution de tâches nouvelles sur un nouveau logiciel (Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945).
Alors que le marché de l’emploi redémarre progressivement en France, le groupe Randstad s’est penché sur l’impact de la Covid-19 sur le sens au travail. Il en ressort que plus d’un Français sur quatre (29%) a le sentiment d’occuper un bullshit job.
Le bullshit job, terme, popularisé par l’anthropologue américain David Graeber, désigne un emploi inutile, dont on ne perçoit pas le sens. Pour 16% du panel, la crise du Covid-19 a agi comme un révélateur.Samuel Durand, auteur et spécialiste des transformations du travail, explique ainsi que le confinement nous a mis face à nous-mêmes et nous a donné le temps d’une réflexion que nous ne souhaitons pas avoir en temps normal. “Et si mon métier était un bullshit job ?” Ce sentiment d’inutilité, voire d’escroquerie, touche de plus en plus de métiers. “Une fois que nous nous sommes interrogés sur la réalité de notre travail, vient le temps de la quête de sens.”Afin de remédier à cette situation et retrouver un intérêt professionnel, les Français envisagent des ajustements de carrière plutôt qu’un changement profond. 17% d’entre eux pensent redonner du sens à leur travail en conservant leur poste mais dans un secteur différent. 12,5% estiment qu’il suffit de changer de poste dans leur entreprise.Les métiers de « première ligne » (infirmier, employé dans la grande distribution, opérateur dans l’agroalimentaire …), glorifiés en début de crise, se révèlent peu attractifs. Seul 2% du panel interrogé occuperait ce type de poste pour s’y épanouir. Lorsqu’on les interroge sur leur envie d’un emploi plus porteur de sens une fois la crise passée près d’un tiers (30%) des Français envisage une mobilité professionnelle.
Frank Ribuot, Président du groupe Randstad France
Frank Ribuot« Le sens au travail est un déterminant essentiel dans l’emploi. Avant la crise, ce paramètre jouait un rôle croissant pour attirer ou retenir les talents. La crise du Covid-19, et notamment le recours massif à l’activité partielle, ont fait voler en éclat les certitudes d’un certain nombre de salariés quant à leur rôle et l’importance de leur fonction. A cela s’ajoutent les interrogations qui pèsent sur le marché de l’emploi pour les mois à venir, qui risquent de voir primer la sécurité de l’emploi sur le sens au travail. Tout l’enjeu pour les entreprises va être de recréer ce lien de confiance avec les collaborateurs et cultiver le sentiment d’utilité qu’ils ont besoin d’éprouver. La sortie de crise doit être l’occasion de revoir la culture managériale, de favoriser l’autonomie et la prise de décision des collaborateurs. Il est capital de réinsuffler une vision partagée du rôle de l’entreprise. Un salarié qui a le sentiment d’occuper un emploi inutile est un salarié malheureux et démobilisé. Dans le contexte de reprise, les entreprises ont plus que jamais besoin de chacun »«Les «bullshit jobs» se sont multipliés de façon exponentielle ces dernières décennies»
Carrières
Nos sociétés échouent à utiliser la technologie pour favoriser les activités utiles et le temps libre, explique l’anthropologue David Graeber
Propos recueillis par Marie Charrel (Le Monde)
Publié lundi 17 septembre 2018 à 11:47
Modifié lundi 17 septembre 2018 à 11:48
Pendant cette année des 20 ans, «Le Temps» met l’accent sur sept causes emblématiques. La cinquième porte sur «l’économie inclusive». Celle-ci vise à mieux tenir des enjeux écologiques, éthiques et égalitaires.
Nous cherchons des idées, des modèles et des personnalités qui, chacun à leur manière, développent une économie et une finance plus intelligentes, qui contribuent à mieux répartir ce qu'elles génèrent entre toutes les parties concernées.
En 2013, il publiait un article choc sur le sujet: d’innombrables salariés de la finance, du marketing ou du secteur de l’information sont aujourd’hui convaincus d’occuper des emplois inutiles, absurdes, voire nuisibles pour la société. Dans son truculent essai Bullshit Jobs («Boulots à la con»), paru le 5 septembre aux Editions Les liens qui libèrent, David Graeber, anthropologue et professeur influent de la London School of Economics, explore les racines de ce phénomène, dont les conséquences ne se limitent pas à la souffrance professionnelle. Car au-delà, explique-t-il, notre société entière échoue à utiliser le progrès technologique comme un outil de libération des individus.
Le Monde: Les emplois inutiles que vous décrivez n’ont-ils pas toujours existé?
David Graeber: Oui, mais ils se sont multipliés de façon exponentielle ces dernières décennies. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter les salariés conscients de la faible utilité de leurs emplois, comme ceux rencontrés pour ce livre: le consultant, dont les rapports ne sont lus par personne, l’assistant brassant de l’air car son chef a besoin de justifier sa position hiérarchique, l’avocat d’affaires gagnant de l’argent uniquement grâce aux erreurs du système… Des millions de personnes souffrent aujourd’hui d’un terrible manque de sens, couplé à un sentiment d’inutilité sociale. Ce qui peut sembler paradoxal: en théorie, l’économie de marché, censée maximiser les profits et l’efficacité par le jeu de la concurrence, ne devrait pas permettre à ces jobs peu utiles d’exister.
Comment expliquer leur prolifération?
Par bien des aspects, le système où nous vivons relève moins du capitalisme que d’une forme de féodalité managériale. Depuis les «trente glorieuses», les salaires ont décroché par rapport aux profits. Ces derniers sont captés par le secteur financier, qui les redistribue à un petit nombre de personnes, comme au Moyen Age, par le biais d’un jeu de strates et de hiérarchies complexe. Dit autrement: la finance d’aujourd’hui contribue peu à la fabrication de biens et services – et donc de valeur. Une grande partie des profits des banques américaines provient ainsi des frais et pénalités infligés aux clients ne respectant pas leurs règles. Une bonne partie provient également de l’achat et vente de dettes contractées par d’autres.
Le problème se résume-t-il à la montée en puissance de la finance depuis quarante ans?
Pas seulement. Il y a un malentendu fondamental lorsque l’on décrit le passage de l’industrie aux services de nos sociétés durant le XXe siècle. La part des services traditionnels – restauration, coiffeurs… – est en effet restée stable au fil des décennies, autour de 20% de la main-d’œuvre. En revanche, celle liée aux emplois du secteur de l’information au sens large – informatique, finance, assurance, communication… – a explosé. C’est là qu’une bonne partie des bullshit jobs se concentrent.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, être payé pour ne pas faire grand-chose engendre une grande souffrance morale. Pourquoi?
Les hommes tirent leur bonheur du sentiment d’avoir prise sur le monde. De contribuer à sa bonne marche, d’une façon ou d’une autre. La violence spirituelle qu’engendre l’absence de sens des bullshit jobs, tout comme le sentiment d’inutilité et d’imposture, est destructrice, moralement et physiquement.
Pourquoi les salariés concernés ne se révoltent-ils pas?
Comment le pourraient-ils? Le travail est aujourd’hui une part déterminante de notre identité – lorsqu’un inconnu vous demande ce que vous faites, vous répondez par votre métier. Tel est le paradoxe de l’emploi contemporain: même lorsque les personnes détestent leur job, elles y restent profondément attachées. Beaucoup tirent même leur dignité précisément du fait qu’elles souffrent au travail. Cela tient à notre conception théologique du travail, enracinée dans la chrétienté: il est un devoir, il est le propre de la condition humaine et «forge» le caractère. Celui qui ne fait pas sa part est indigne. Cette vision est, en outre, l’autre face du consumérisme: on souffre au travail pour s’autoriser ensuite à consommer une fois rentré à la maison.
Pourquoi les métiers les plus utiles socialement, comme les infirmières ou les instituteurs, sont-ils si peu considérés?
Ils sont également mal payés: on observe une relation inverse entre la valeur sociale d’un emploi et la rémunération que l’on en tire. C’est vrai pour tous les jobs liés au soin des personnes (à l’exception des médecins). Ces emplois engendrent une forme de «jalousie morale», c’est-à-dire un ressentiment face aux activités dénotant une plus grande élévation morale. Tout se passe comme si la société entière songeait: les infirmiers, les instituteurs, eux, ont la chance de compter dans la vie des autres, ils ne vont pas en plus réclamer d’être bien payés! Il en va de même avec les artistes.
Ce ressentiment nourrit-il le populisme?
Oui. Aux Etats-Unis, le populisme de droite a deux caractéristiques: le respect du corps militaire et la haine des élites progressistes, en particulier culturelles. Les deux sont liés. Pour les enfants des classes populaires, intégrer l’«intelligentsia» est un rêve plus inaccessible encore que celui de gagner de l’argent, car cela exige des réseaux dont ils ne disposent pas. Pour eux, la seule institution offrant une possibilité d’ascension sociale est l’armée.
En 1930, Keynes prédisait que l’automatisation des tâches permettrait de limiter le temps de travail à vingt heures par semaine. Pourquoi cela ne s’est-il pas produit?
C’est l’autre paradoxe de l’époque: alors que nos grands-parents rêvaient que l’automatisation libère leurs enfants des travaux difficiles, nous craignons aujourd’hui que les robots ne prennent nos emplois. Mais si cela se produit, et que plus personne ne touche de salaire, qui consommera les biens fabriqués pas les machines? Nos économies échouent à utiliser l’automatisation pour libérer les individus des bullshit jobs, parce qu’elles sont incapables de concevoir une autre organisation, où le travail tiendrait une place différente.
Cette libération pourrait passer par l’instauration d’un revenu de base, selon vous. Quels sont les obstacles?
En grande partie, la conception théologique du travail que nous avons évoquée. Les sceptiques disent: si l’on donne un revenu à tout le monde, certains en profiteront pour ne rien faire, ou deviendront des mauvais poètes dont on n’a pas besoin. Mais en quoi serait-ce pire que les jobs absurdes d’aujourd’hui? Au moins, les individus seraient plus heureux. Nous passons nos journées à rêver de ce que nous pourrions faire si nous avions du temps, mais politiquement, nous ne sommes pas prêts. Au cours des millénaires, nombre de sociétés sont pourtant parvenues à une organisation où l’occupation du temps libre n’était pas un problème, et où des classes entières n’étaient pas contraintes de consacrer leur vie à des activités qu’elles haïssent.
Bullshit Job : en français un « job à la con ».
C’est un emploi qui est si totalement inutile que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence.
Il ne faut pas confondre bullshit job et job de merde. Un job de merde est un travail difficile et souvent mal payé, mais qui est utile pour la société. Par exemple, travailler pour la hotline d’une entreprise et recevoir des appels de clients mécontents toute la journée est un job de merde (et tout ça pour un salaire de misère), mais ce n’est pas un bullshit job.
Les bullshit jobs se trouvent principalement dans les grandes entreprises du privé et les administrations publiques. Dans les petites entreprises les gens ont tendance à effectuer un travail concret dont l’utilité est facile à mesurer, l’employé n’est pas noyé dans la masse.
L'anthropologue américain David Graeber a écrit un livre consacré à l’étude des bullshit jobs.
Voici quelques catégories de job à la con dont il parle dans son livre :
• Les larbins. Les jobs de larbins sont ceux qui ont pour seul but de permettre à quelqu'un de se sentir important. «Il existe encore des boulots de domestiques à l'ancienne, soutient David Graeber. À travers l'Histoire, les riches et les puissants ont eu tendance à s'entourer de serviteurs, de clients, de flagorneurs et autres laquais.»
• Les rafistoleurs. Qui sont les rafistoleurs ? Ceux dont le job n'a d'autre raison d'être que les anomalies qui entravent le bon fonctionnement une organisation. Ils sont donc là pour régler des problèmes qui ne devraient plus exister si ces anomalies avaient été corrigées. «Les premiers exemples de rafistoleurs auxquels on pense, ce sont des subalternes dont le boulot est de réparer les dégâts causés par des supérieurs hiérarchiques négligents ou incompétents», nous dit le livre Bullshit Jobs.
• Les cocheurs de case. Il s'agit d'employés dont la seule principale raison d'être est de permettre à une organisation de prétendre faire quelque chose qu'en réalité elle ne fait pas. Souvent on assiste au phénomène de la réunionnite : des réunions sans cesse, pour le principe, et sans intérêt apparent ni aucune prise de décision. Graeber explique que dans la majorité des cas, les cocheurs de case sont tout à fait conscients que leur job n'aide en rien la réalisation du but affiché. Pire encore : il lui nuit, puisqu'il détourne du temps et des ressources. «L'essentiel de mon travail consistait à interviewer les résidents afin de noter leurs préférences personnelles dans un formulaire, explique ainsi une employée qui était chargée de coordonner les activités de détente dans une maison de repos. Les résidents savaient très bien que c'était du pipeau et que personne ne se souciait de leurs préférences.»
• Les petits chefs. C'est peut-être le profil le plus connu... et le plus détesté aussi. Les petits-chefs se divisent en deux sous-catégories. Ceux du premier type n'ont qu'une fonction : assigner ou déléguer des tâches à d'autres. Ils peuvent être considérés comme le reflet inversé des larbins : ils sont tout aussi superflus, mais au lieu d'être les subordonnés, ce sont les supérieurs. Si cette première sous-catégorie est inutile, la seconde est nuisible : il s'agit des petits chefs dont l'essentiel du travail consiste à créer des tâches inutiles qu'ils confient à leurs subalternes, ou même à créer de toutes pièces des jobs à la con.
Multiplication des réunions, de la paperasse, des couches hiérarchiques, des sous-traitants… le pourcentage de jobs à la con dans le monde du travail serait monté en flèche, un phénomène en partie lié au gonflement du secteur de l’information, et de toutes les formes de travail immatériel. Des réunions interminables au cours desquelles des gens aux titres compliqués ("coordinateurs de la dynamique de la marque", "responsables de la vision prospective") déroulent des présentations Power Point, des rapports, des graphiques sur des sujets pour lesquels rien ne sera finalement jamais décidé.
Le problème principal posé par les jobs à la con, c'est que si l'on devait tous les supprimer, cela aboutirait assurément à augmenter le chômage dans proportions très importantes.
Le job à la con a donc une fonction sociale car il offre un salaire en échange du temps passé par l’employé à s’ennuyer au bureau. Parfois l’employé s’ennuie dans son job à la con et n’aime pas ce travail mais son niveau d’irritation n’est pas suffisant pour prendre le risque de passer à autre chose.
En principe quelqu’un qui bosse majoritairement en télétravail ne peut pas tomber dans les catégories « petit chef », larbin et « cocheurs de case». En effet le télétravail implique une organisation des équipes où ces «activités à la con» ne peuvent pas apparaître.
Un employé en télétravail peut être un rafistoleur. Par exemple un développeur informatique peut maintenir un système informatique obsolète car mettre en place un nouveau système informatique est jugé trop coûteux.
Prêt à trouver un job de rafistoleur en télétravail (humour...) ? ;)
Produire ou servir plus, avec moins : c’est l’injonction faite à tous les travailleurs, des chaînes de montage automobiles aux couloirs des hôpitaux, en passant par les salles de classe ou les bureaux de poste. Une violence sociale féroce dans laquelle les journalistes Julien Brygo et Olivier Cyran ont plongé pour écrire leur ouvrage Boulots de merde.
Basta! : Le titre de votre livre, Boulots de merde, se réfère au texte de l’anthropologue David Graeber sur les « bullshit jobs » [1]. Il y décrit les métiers absurdes qu’induit le capitalisme financier, tels que ceux exercés par les avocats d’affaire, lesquels s’ennuient prodigieusement au travail. Mais pour vous, les bullshit jobs ne concernent pas que les cols blancs, loin s’en faut. Pourquoi ?
Julien Brygo et Olivier Cyran [2] : Nous avons été séduits par cette idée de David Graeber selon laquelle, dans le capitalisme financier, des millions d’individus sont employés à ne rien faire d’utile, comme effectivement les avocats d’affaire : ils sont bien payés et très reconnus socialement, mais ils s’ennuient tellement au travail qu’ils passent leur temps à télécharger des séries ou à réactualiser leur page Facebook. Ceci dit, il nous semble que les « vrais » boulots de merde, ce sont quand même plutôt ceux qui sont exercés en bas de l’échelle sociale dans les secteurs du nettoyage, de la restauration, de la livraison à domicile, de la distribution de prospectus publicitaires, etc. Bref : des métiers pénibles où l’on paie de sa personne, qui participent à la croissance du PIB et à la baisse des chiffres du chômage.
Nous pouvons y ajouter les boulots « utiles » comme les infirmières, les professeurs ou les facteurs, dont les conditions se sont tellement dégradées qu’ils deviennent vraiment « merdiques » eux aussi. Nous avons voulu incarner ces vies et tracer un lien avec les gestionnaires de patrimoine et autres héros financiers tels que les journalistes boursiers, qui exercent des métiers nuisibles socialement : les gestionnaires de patrimoine font partie des organisateurs de ce qui est appelé béatement « l’optimisation fiscale » et qui prive la collectivité des recettes de l’impôt.
« À la faveur de l’entassement des richesses dans les mains d’une élite de plus en plus dodue et capricieuse, le secteur des tâches domestiques où l’on s’abaisse devant son maître se répand », dites-vous. Pouvez-vous détailler ?
Entre 1995 et 2010, dans le monde, le nombre de travailleuses domestiques a grimpé de plus de 60 %. 52 millions de femmes exercent ces « métiers ». Cette hausse correspond à la montée des inégalités. On revient à une économie de type féodale, une économie de la domesticité dans laquelle les plus riches sous-traitent leur confort en employant une nounou, ou bien une, deux ou trois bonnes. Le tout avec le soutien de l’État puisque, par exemple, la gauche plurielle de Lionel Jospin a instauré en France le subventionnement de tous ces métiers via les crédits d’impôts.
Des métiers que l’on croyait disparus, parce que réservés à une époque de semi-esclavagisme, refont leur apparition, comme les cireurs de chaussures, parfois avec l’étiquette « économie sociale et solidaire ». Suite à un appel à projets lancé en 2012 dans le département des Hauts-de-Seine, sous l’égide de Jean Sarkozy, le réseau « les Cireurs » a ainsi obtenu 50 000 euros de subvention au titre de « l’aide à l’économie sociale et solidaire ». Fondé par une diplômée d’école de commerce, ce réseau réunit des individus qui, en contrepartie du droit d’usage de l’enseigne (censée appâter le chaland), acceptent d’être auto-entrepreneurs. Pas d’indemnités en cas d’arrêt maladie, aucun droit aux allocations chômage.
Au lieu d’un salaire, le cireur touche un cachet horaire sur lequel il doit payer lui même une taxe de 23 %. De son côté, la structure démarche des centres commerciaux pour leur vendre l’implantation de ses « artisans cireurs ». Les cireurs paient de leur poche le matériel et l’habillement. S’ils n’ont pas les moyens d’investir, ils peuvent obtenir un prêt accordé par l’association pour le droit à l’initiative économique à un taux d’intérêt compris entre 6 et 8 % ! Au final, la rémunération du cireur est maigre, sa précarité totale. Mais on nous vend un métier « renouvelé », avec des gens qui travaillent « pour eux », sous prétexte qu’ils ne sont pas salariés.
« Je ne gagne pas un Smic, ça c’est clair », dit un cireur de chaussures que vous citez. Mais les auto-entrepreneurs ne sont pas les seuls à travailler à bas coût. Vous expliquez que des millions de salariés travaillent bien en-deçà du Smic.
On entend partout que le Smic c’est « l’ennemi de l’emploi ». Mais le Smic n’existe plus depuis longtemps. Il existe de nombreuses manières de passer outre le salaire minimum. Par exemple, le CDI à temps partiel, avec la pré-quantification du temps de travail. C’est ce qui a été négocié par les géants de la distribution de prospectus publicitaires, Adrexo et Médiapost. Les salariés que nous avons rencontrés travaillent 30% de plus en moyenne que ce qui est indiqué sur leur contrat, et que ce qui leur est payé. Un couple de retraités touchait à peine trois euros de l’heure, soit deux fois et demi moins que le Smic ! La convention collective de la restauration est un autre moyen de faire travailler les gens gratuitement : les heures supplémentaires ne sont pas payées. Résultat ? Les salariés sont payés 24 heures, et en font 60. Le reste étant – parfois – payé au black. Dans les secteurs où la France est championne – le tourisme, la grande distribution, l’hôtellerie-restauration… –, il y a au moins deux millions d’emplois payés entre 25 et 80 % du Smic !
Il y a en fait une vraie fascination du patronat pour le travail gratuit, et les dirigeants politiques s’empressent de leur donner des outils juridiques qui légalisent cette gratuité : prenons le service civique payé deux fois moins qu’un Smic – et même seulement 1/10e du Smic pour l’employeur – ; ou encore le contrat de professionnalisation auquel recourt beaucoup la grande distribution : pour 150 heures de formation théorique – qui consiste en fait à remplir des rayons ou à faire du nettoyage – l’entreprise touche 2 250 euros par contrat. Le dispositif coûte des millions d’euros aux contribuables chaque année.
Y a-t-il là une spécificité française ?
La grande distribution, c’est une spécialité française. Et le secteur est friand de boulots dégradés. Le projet Europacity (immense centre commercial à proximité de Paris, ndlr), du groupe Mulliez et de sa filiale Immochan, c’est la promesse de 10 000 boulots de merde. Autre secteur passionné par cette économie du « larbinat » : le tourisme. Dans les Alpes, des vallées entières sont de véritables réservoirs à larbinat : tout le monde travaille pour les quelques privilégiés qui peuvent se payer des sports d’hiver. Il y a des contrats prévus pour les CDI à temps partiels, les intermittents, les apprentis, les stagiaires, etc. Précisons que la France est aussi championne du monde des anti-dépresseurs et des médicaments, notamment pour supporter tous ces travaux infernaux.
Le secteur privé n’est pas le seul à malmener les travailleurs. Les fonctionnaires sont eux aussi essorés par les « restructurations » de services et les suppressions de postes en pagaille. Que vous-ont raconté les fonctionnaires que vous avez rencontrés ?
L’obsession pour la réduction des effectifs est un drame. Tout le monde semble s’accorder pour dire qu’il est important de réduire le chômage. C’est constamment dans la bouche des responsables politiques. Mais la phrase d’après, c’est : « Je m’engage à virer 500 000 fonctionnaires ». Parce qu’ils n’arrivent pas à se figurer que des métiers qui ne dégagent pas de marge financière puissent néanmoins être utiles. Tout doit être « rentable ». Nous payons des années de convergence idéologique entre les élites politiques et les détenteurs du capital. Les gens chargés de « réorganiser » drastiquement le CHU de Toulouse, où nous avons fait un reportage, sortent d’écoles de commerce. Ils ont officié chez Carrefour, Pimkie et Danone. Ils se retrouvent à gérer sur ordinateur de l’humain, alors qu’ils ne connaissent que les chiffres.
Les aides soignantes et les infirmières sont censées remplir des chiffres bêtement sans se poser de questions. Elles doivent soigner tant de malades en une journée, peu importent les spécificités des personnes malades ou les imprévus. Elles ont tant à faire en si peu de temps que leur travail est devenu impossible (Ndlr : lire notre article sur le sujet : Sauver des vies en temps de crise : le difficile quotidien des infirmiers). En fin de journée, elles sont épuisées et complètement stressées parce qu’elles ne savent plus si elles ont posé correctement telle perfusion, donné tel médicament à la bonne personne au bon moment...
Tous les services publics sont touchés par cette recherche de rentabilité. Les facteurs se sont ainsi transformés en vendeurs de systèmes de télésurveillance, ou en promeneurs de chiens. L’objectif est de soutirer de l’argent à cette importante manne financière que sont les vieux en France. Cela porte évidemment atteinte à la dignité des facteurs, qui ont toujours aidé les plus anciens au cours de leurs tournées, mais gratuitement ! Les policiers de leur côté sont devenus des machines à gazer des manifestants ou des réfugiés. Certains en ressentent un certain malaise. Être obligé de reconduire tant de migrants à la frontière chaque année, cela n’est pas sans conséquences mentales sur les personnes.
Vous expliquez que tous ces « remaniements » de services publics sont inspirés du « lean management », une méthode élaborée dans les années 1950 au Japon par les ingénieurs de Toyota, et revue par le très libéral Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis au début des années 1990. Comment cela se traduit-il dans le monde du travail ?
Le « lean management » est devenu la marotte des directions de ressources humaines, et s’immisce et se propage dans tous les secteurs du monde du travail : dans les multinationales ou les services publics, chez les gros industriels et les sous-traitants. Il consiste à imposer aux salariés de faire plus avec moins, en s’attaquant notamment à tous les temps morts : les pauses jugées superflues, les respirations qualifiées d’improductives, toutes les minutes qui ne sont pas « rentables ». Dans nos reportages, tout montre que les travailleurs n’arrivent pas à faire face à cette intensification du travail. Ce qu’on leur impose en terme de rythme et d’objectifs n’a plus de sens. Nous nous dirigeons vers un état de souffrance au travail généralisée. Il y a des vagues de suicides partout. Et on parle là des secteurs de la santé ou de l’éducation : ce sont des secteurs fondamentaux de notre vie sociale.
Tout cela ne se fait-il pas avec le prétendu assentiment des salariés, que l’on somme de participer au changement organisationnel ?
Si. C’est toute la perfidie du « lean management ». On donne aux salariés l’illusion qu’ils peuvent changer le système ; en fait on les oblige à accepter de se faire humilier. C’est le principe de la bonne idée rémunérée chez PSA : 300 euros pour l’idée simple, 500 euros pour la super idée, 1 000 euros pour l’excellente idée. On fait croire aux salariés qu’ils sont d’accord et qu’ils valident le système. Alors que c’est faux, bien entendu. Neuf salariés sur dix pensent qu’ils ont besoin de plus de collègues, et de plus de temps pour pouvoir bien faire les choses. Un infirmer de Toulouse nous a expliqué qu’il a besoin de moins de produits anesthésiants lorsqu’il prend le temps de parler avec ses patients avant de les endormir. Mais ce n’est pas du tout intégré par la nouvelle organisation. Il doit faire vite, endormir tant de patients en une journée, peu importe si pour cela il doit consommer plus de produits. Toute cette organisation du travail a des effets criminels : il y a eu quatre suicides cet été à l’hôpital de Toulouse.
En France, la « loi travail », qui a fait l’objet d’une intense mobilisation durant l’année 2016, a-t-elle pour conséquence d’entériner ces méthodes ?
Avec cette loi, qui vise à faire passer le code du travail au second plan, on s’éloigne encore davantage du principe « une heure travaillée = une heure payée ». Elle est taillée sur mesure pour les entreprises qui veulent en finir avec le salariat. L’article 27 bis précise par exemple qu’il n’y a pas de lien de subordination entre les plate-formes de mise en relation par voie électronique comme Uber et les auto-entrepreneurs qui travaillent pour elles. C’est ce lien qui définit le salariat et permet entre autres aux travailleurs d’aller aux Prud’hommes faire valoir leurs droits. On désarme complètement les travailleurs, alors qu’ils subissent un vrai lien de subordination – ce sont les plate-formes qui leur donnent du travail, évaluent les travailleurs et les sanctionnent – sans les compensations garanties par le statut salarié.
Un livreur à vélo pour une « appli » de repas à domicile le souligne dans notre livre : « Pour arriver à un salaire intéressant, il faut travailler une soixantaine d’heures par semaine. Sur ce revenu, il faut payer environ 23% d’impôts au titre de l’auto-entrepreneuriat. L’arnaque totale. T’es taxé alors que eux, tes patrons, ils ne paient aucune cotisation sociale. » Les livreurs sont incités à aller très vite, quitte à frôler les accidents, étant donné qu’ils sont payés à la course. Et celui qui tombe de son vélo, il se fait non pas virer, mais « éliminer ». Il « quitte le jeu », en quelque sorte. Il ne touche plus aucun salaire, ni aucune indemnité. C’est un système d’une violence incroyable, qui se fait passer pour cool, jeune et dynamique. Les livreurs n’ont pas le droit au scooter, ils ne doivent rouler qu’à vélo – qu’ils doivent se procurer eux-mêmes – parce que cela donne une image écolo à l’entreprise...
Vous reprochez aux médias leur complicité avec ces conceptions très libérales du travail...
Les médias jouent un rôle central dans la diffusion de cette idée sous-jacente que la précarisation est nécessaire. Il faut travailler pour avoir une existence sociale quels que soient l’emploi et les conditions de travail. Le fait de donner chaque mois les chiffres du chômage nous plonge dans une vision statisticienne du monde, avec cet objectif de faire baisser le chômage quoi qu’il en coûte. Les journalistes relaient avec beaucoup de zèle cette idée selon laquelle « mieux vaut un mauvais travail que pas de travail du tout ». Cela devient légitime d’accepter un boulot de merde simplement parce qu’il est proposé. Évidemment, pour rien au monde les journalistes ne feraient ces boulots de merde. Nous avons là une vision de classe.
Les médias jouent aussi beaucoup avec la culpabilisation du chômage, en répétant sans cesse à quel point c’est honteux de ne pas travailler, et en enchaînant les « Une » sur les avantages de l’auto-entreprenariat. Nous sommes étonnés de constater, même autour de nous, à quel point les gens ont honte de dire qu’ils touchent des prestations sociales. Alors que cet argent, les gens l’ont cotisé, via leurs boulots antérieurs. Ce sont des garde-fous qui ont été mis en place pour éviter que des gens ne tombent dans la misère totale.
Les médias sont par ailleurs très sévères quand ils décrivent les luttes sociales, comparant volontiers les grévistes avec des preneurs d’otages, ou les manifestants avec des casseurs. Entre ces jugements très négatifs et la répression qui va grandissante, les luttes collectives peuvent-elles se faire une place, et redonner du sens au travail ?
Il nous semble que le patronat va tout faire pour imposer l’idée selon laquelle il faut qu’on accepte cette société de mini-jobs, sans salaire minimum, avec des contrats « modernes », c’est-à-dire au rabais, davantage proche de l’auto-entrepreunariat que du salariat avec ses « acquis » sociaux qu’ils jugent « insupportables ». Au niveau juridique et législatif, tout est bouché. L’inspection du travail est attaquée de front. Les procédures prud’hommales engendrent parfois plus de cinq ans d’attente – et de paperasse – pour obtenir réparation et se faire rembourser l’argent volé. C’est un combat très inégal.
La criminalisation des mouvement sociaux et la répression des luttes collectives répondent à l’obsession politique clairement formulée qui vise à désarmer la CGT : ils veulent empêcher les travailleurs de reprendre le contrôle de leur travail et d’exercer leur capacité de nuisance sociale afin d’inverser un rapport de force. Cela indique que le patronat et ses relais politiques sont prêts à un affrontement, qu’ils exigent même la violence de cet affrontement.
Ils veulent faire sauter les derniers verrous, ils veulent une société sans filets, où quelques privilégiés auront accès à des métiers survalorisés socialement et correspondant même à des compétences, tandis qu’en bas, ils poseront les jalons d’une société de logisticiens du dernier mètre payés à la tâche, esclaves des machines et de l’auto-exploitation auquel le capitalisme les auront assignés presque naturellement. Et lorsque le logisticien sera remplacé, il pourra toujours louer sa maison, sa guitare, sa voiture, pourquoi pas vendre père et mère, pour ne pas sombrer dans la misère ni « vivre avec la honte » d’être un « assisté ». On va sans doute aller vers une radicalisation des mouvements sociaux. Avec une grande répression derrière. C’est la seule possibilité pour le libéralisme économique de continuer à structurer nos vies : par la force.
Propos recueillis par Nolwenn Weiler
Quand je bossais à la Poste il y a de ça quatre ans, je me souviens d'une discussion animée que j'ai eue avec un collègue de travail. Le mec était là depuis de longues années. Il me racontait chaque semaine ses virées aux putes durant le week-end, qui se résumaient toujours à peu de chose près, à la même rengaine. Sans foyer, sans vrais amis, il se tapait la route depuis Paris jusqu'à Bruxelles ou Amsterdam tous les vendredis pour se décalaminer le manche sur des prostituées. Si je lui avais demandé pour quoi il vivait, il m'aurait sûrement répondu pour les baises facturées et les matchs du PSG.
Il y a ceux qui ont leur voie bien tracée. Ils sortent de leur lycée de quartier et foncent droit sur leurs études dans un but précis : travailler dans le droit, la médecine, le commerce, le management ou l'éducation nationale. Et puis il y a ceux qui divaguent, qui ne trouvent pas, dans ce qu'on leur propose, un projet de futur. Ils rêvent d'autres horizons qu'ils n'atteindront jamais. Alors ils rôdent dans la vie active, de jobs en jobs. Ils sont parfois étudiants à mi-temps à la fac dans des départements obscurs et sans débouchés. Quand il n'y a aucun projet de vie concret, pas de futur, il vous reste toujours les jobs alimentaires.
Je suis resté à la Poste pendant un bon moment. J'étais préposé au tri et on ne peut pas dire que ce soit un boulot franchement épanouissant. C'est ce que m'avait donné la boîte d'intérim quand je m'étais pointé dans leur bureau, la tronche enfarinée. Je sortais du lycée à l'époque, et tout le tintouin comme quoi « le travail et la carrière » c'est ce qu'il y a de plus respectable pour un bonhomme, j'en avais rien à cirer, comme beaucoup d'autres. C'est toujours le cas d'ailleurs. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas encore expérimenté et j'ouvrais ma gueule sans rien en savoir.
Je passais les heures de travail devant une espèce de machine géante qui faisait défiler des caisses pleines à craquer de courriers sur des tapis roulants. De là sortaient des rampes, tout autour, qui acheminaient le courrier jusqu'à des emplacements donnés en fonction des destinations, classées elles-mêmes par départements français. Mon taf, c'était d'attendre devant l'une de ces rampes, en binôme, et de remplir des chariots avec les caisses en fonction des destinations.
Quand ça arrivait, ça dégueulait par dizaines. C'était le marathon. Empiler des bacs de courriers les uns sur les autres, nouer les lanières, et ainsi de suite, pendant des heures. Cette tâche accomplie, il faut ensuite traîner tous les chariots triés devant de grandes portes coulissantes où viennent se garer les camions. Il y a des moments d'accalmie lors desquels on peut tranquillement causer avec le camarade et zieuter la belle et sainte horloge. Un tas de types bossaient là depuis vingt ou trente ans et s'étaient accommodés depuis longtemps à cette routine infernale.
Sérieux, comment peut-on passer sa vie à s'échiner à trier du courrier ?
Photo via
Là-bas, j'agissais un peu comme un sociologue. Je cherchais à comprendre les mecs, et je leur posais un tas de questions. Je m'intéressais à leur vie, j'écoutais ce qui se disait. Les gars qui avaient leurs postes fixes depuis des lustres étaient complètement résiliés. Mais on se marrait bien, malgré l'âpreté du travail.
Bien sûr, là-bas vous avez à disposition quelques bons gros clichés de base comme dans n'importe quelle société. Les mecs se pintent la tronche le soir pour oublier le taf et attendent les vacances. Pendant les temps de pause, des bandes de travailleurs se réunissaient dans des salles mises à leur disposition pour jouer aux cartes, et je fumais mes clopes, peinard, louant le bonheur des petits breaks de la journée. Il faut noter qu'il y a un véritable esprit de camaraderie, un côté bon enfant qu'on ne trouve pas dans d'autres milieux.
L'autre partie du job consistait à charger les camions. On m'a planté devant une porte où se dressait un bon paquet de ces chariots triés la veille par d'autres types. Je devais faire les dernières vérifications de destinations, au cas où il y aurait une connerie dans le lot. Quand le camion venait se planter, je le remplissais et en profitais pour fumer une clope avec le coursier qui allait se taper la route de nuit pour acheminer tout le courrier.
Voilà ce en quoi consistait mon travail de postier - agent de tri. Quand j'en ai eu ma claque, je suis passé à un autre job alimentaire.
Photo via
La vente, je crois bien que ça a été le pire pour moi, qui suis de nature plutôt misanthrope. C'est ce que j'ai compris en bossant dans une grande chaîne française de produits surgelés. La journée s'articulait, comme à la Poste, sur des tâches répétitives et abrutissantes. Dans un premier temps, on m'a formé pour jouer les caissiers. J'ai appris comment encaisser les gens selon les différents moyens de paiements en utilisant à bon escient toutes les options et raccourcis offerts par les machines. Pour passer le temps, j'essayais de voir ce qui était le plus consommé entre les petits pois surgelés et les haricots. Dans ma tête, je m'attelais à des jeux totalement débiles du genre, comme si grâce à ça la journée allait passer plus vite.
Puis tout en gérant la caisse, les connards comme les gens courtois, il fallait que je classe ce qui venait de la chambre froide dans les différents congélateurs du magasin : des caddies entiers. Il y avait toujours de quoi faire, en plus de guetter les vieilles qui tentaient de piquer du poisson pané. Les petites joies de la journée sont rares et on s'accommode : une jeune femme sexy qui passe à la caisse avec un grand sourire, par exemple. Alors on les attend. Y'a aussi des instants comme celui-là : un vieux qui débarque avec une grimace effroyable et qui vous demande du tac au tac, sans passer par quatre chemins, s'il peut aller chier dans les toilettes des employés.
Mais ce que j'ai le plus pratiqué, ça doit être le chantier. La première fois, on m'avait embauché comme câbleur en CDD alors que je n'y connaissais que dalle, moi avec mon bac littéraire. J'ai fait beaucoup de découpe de câbles et, en comptabilisant toutes mes missions, sans doute assez pour faire le tour du globe. Pendant des journées, dans un atelier, je tirais différents types de câbles – de l'audio, du vidéo, de la fibre – dans le but de les installer sur un chantier : sans arrêt, je devais tirer des kilomètres. Je bricolais aussi des connecteurs, j'installais du jack ou du vga, du rj45 au bout de câbles de toutes sortes. On m'enseignait perpétuellement des tâches nouvelles, souvent méticuleuses. Je devais savoir les faire à la perfection pour pouvoir les pratiquer sur commande, et seul. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai dû apprendre un métier de A à Z. Et, de fait, c'était déjà plus intéressant qu'une grande partie de mes autres boulots.
Puis on m'a foutu sur le concret, le chantier. Avec une équipe de collègues, on passait des câbles entre les différentes parties d'un bâtiment qui serait, dans un futur proche, investi par une entreprise du secteur audiovisuel. Il fallait installer le câblage nécessaire à leur matos sonore et visuel, dans du faux plancher, de faux plafonds. Ça m'excitait au début, d'être l'ouvrier poussiéreux, outils à la taille, pinces et autres cutters, la tête dans un canal, à cinq mètres de hauteur, ou bien enfoui dans un sous-sol. J'étais content de sortir de l'atelier gris. L'ambiance était bonne et sur les longs chantiers, on se faisait vite amis avec les collègues : on partageait les repas, les cafés, les longues heures de boulot. On bossait parfois en dehors des codes du travail, cumulant un nombre d'heures incroyables dans une journée, lorsqu'il fallait à tout prix boucler le truc pour le client. C'est la réalité du bordel. Ce qui permet de tenir longtemps dans ce genre de taf, c'est la camaraderie prolétaire indiscutable et belle. Probablement.
Photo via
Tu te prends tout ça dans la tronche, l'intégration sociale avec la besogne et le blé : un vrai ramassis de conneries et de trucs infects qu'il faut supporter parce qu'on est bien obligé de bouffer et d'avoir un toit. On enchaîne les boulots ingrats sans lendemains, et il n'y aura jamais vraiment ce que l'on cherche, alors autant se le dire carrément. Ces jobs alimentaires se ressemblent tous dans leur annihilation de l'humain.
Et puis il y a ceux qui croient travailler avec plaisir, qui se sont collé ça dans leur crâne tellement fort que ç'en est devenu une évidence – mais c'est encore autre chose. J'ai le droit de dire que je n'ai pas envie de bosser et que j'en ai rien à cirer du respect du travail. Comme une espèce d'insatisfaction chronique qui pèse sur bon nombre d'entre nous devant la vie qu'on nous offre sur un plateau. Et je sais bien qu'il y en aura d'autres pour moi, dans le futur, de ces labeurs avilissants, de ces travaux forcés.
De votre grand-père à votre département des ressources humaines, en passant par Kim Kardashian, les gens se plaignent constamment que les jeunes sont paresseux et paresseuses. Pire encore, selon eux, nous sommes dans une ère où plus personne ne veut travailler.
Mais comme le soulignait récemment sur Twitter le professeur de l’Université de Calgary Paul Fairie – article de journal datant de 1894 à l’appui –, c’est un trope populaire depuis très longtemps.
Malgré le fait que le taux de chômage ait augmenté le mois dernier, il est plus faible qu’avant la pandémie.Il est vrai que dans les deux dernières années, plusieurs personnes ont quitté leur emploi. Les expert.e.s ont appelé ce phénomène « la Grande Démission ». Mais en fait, ç’a surtout été la Grande Promotion, puisque les chiffres montrent que la plupart des gens qui ont quitté leur job sont simplement allés travailler ailleurs, pour un meilleur salaire et de meilleures conditions.
Ce n’est pas vraiment que plus personne ne veut travailler, c’est que plus personne ne veut travailler dans une job de merde.
D’où est-ce que ça vient?
Au début de la pandémie, face à l’incertitude qui régnait, plusieurs compagnies ont soit fermé leurs portes, soit effectué des mises à pied. Pour aider ses citoyen.ne.s dans une situation financière précaire, le Canada a mis sur pied la Prestation canadienne d’urgence, qui octroyait 500 $ par semaine aux gens éligibles. Très vite, des employeurs (et des vieux frustrés) se sont mis à se plaindre que les jeunes ne voulaient plus travailler, et que c’était la faute du gouvernement, qui payait les jeunes à ne rien faire.
Mais ce genre de discours est un peu de mauvaise foi. Si les 2000 $ par mois versés à travers la PCU a permis à tes ancien.ne.s employé.e.s de mieux vivre que le salaire que tu leur offrais, c’est toi, le problème, et c’est pour ça que personne ne veut travailler pour toi.
La pandémie aura eu comme effet de nous rappeler que la vie est courte et qu’il faut la vivre pleinement. Les millions de documentaires de nature qu’on a regardés en confinement nous ont fait nous questionner sur les attentes de la société, qui prône un travail acharné et peu récompensé.
Pour les gens de notre génération, des emplois difficiles et mal rémunérés, c’est terminé! Travailler, d’accord, mais pas pour n’importe qui et sous n’importe quelles conditions. On veut des jobs où on se sent valorisé.e.s et où on peut, de manière tangible, ressentir que le travail que l’on fait a un réel impact. Et vu que tout coûte plus cher, ça serait quand même nice si on pouvait être adéquatement rémunéré.e.s.
Est-ce que c’est vrai?
Ce qu’il y a de plus frustrant avec le trope que « personne ne veut travailler », c’est surtout qu’il est très facile de prouver que ce n’est pas vrai. Malgré le fait que le taux de chômage ait augmenté le mois dernier, il est plus faible qu’avant la pandémie. Plus d’un demi-million de personnes de plus sont employées aujourd’hui comparativement à en février 2020. De plus, il suffit d’aller voir la section d’offres d’emplois sur LinkedIn pour s’apercevoir que plusieurs d’entre elles reçoivent des centaines de candidatures.
Non seulement nous sommes plus nombreux et nombreuses à travailler, mais nous travaillons plus que les générations précédentes, et tout ça pour être la première génération à moins bien vivre que ses parents. Fun!
Alors pourquoi est-ce que ce mythe persiste?
J’aimerais pouvoir vous dire que notre génération n’aura pas cette mentalité, et que dans une quinzaine d’années, on pourra se départir des stéréotypes qui veulent que les « les jeunes sont paresseux » et que « plus personne ne veut travailler ». Mais, statistiquement, ça ne sera probablement pas le cas. Au fur et à mesure que l’on vieillit, les jeunes ont de nouveaux outils, de nouvelles ambitions et de nouveaux conforts qui nous étaient impensables à leur âge. On se dit donc que leur vie est plus simple, et on les regarde d’un autre oeil, sans se mettre à leur place.
Une recherche de l’Université de St-Louis a démontré que ce générationalisme est bien ancré dans l’humanité, et qu’on en trouve des preuves depuis toujours. Les plus vieux trouvent toujours les plus jeunes plus paresseux et égoïstes.
il suffit d’aller voir la section d’offres d’emplois sur LinkedIn pour s’apercevoir que plusieurs d’entre elles reçoivent des centaines de candidatures. Bon, peut-être que devenir vieux, chiant et condescendant avec les jeunes, c’est inévitable et que dans quelques années, on se fera répondre « OK, millennial » par un kid né en 2018 quand on dira quelque chose de ringard. Mais on peut, au moins, essayer de se départir de l’idée que la pénurie de main-d’œuvre est attribuable à la paresse des jeunes ou au fait que « plus personne ne veut travailler ».
Parce que même si personne ne veut travailler, tout prouve qu’on continue de le faire, et plus que jamais!
L’anthropologue David Graeber a théorisé le phénomène des bullshit jobs (littéralement « jobs à la con ») dans un ouvrage paru en France en septembre dernier. Il a recueilli des centaines de témoignages pour illustrer son propos. Voici quelques exemples de boulots respectés, souvent bien payés… mais vides de sens.
S’ennuyer au bureau, se sentir inutile, être payé à rien faire et culpabiliser… Dans le monde du travail moderne, les métiers à la con se multiplient et les salariés en souffrent. C’est le constat que l’anthropologue américain David Graeber dresse dans son ouvrage Bullshit Jobs (éditions Les Liens qui Libèrent), sorti en France le 5 septembre.
L’auteur a mis des mots sur ce mal pour la première fois dans un article paru en 2013 dans le magazine anarchiste anglais Strike ! Après avoir reçu des centaines de témoignages, il a théorisé ce phénomène dans cet ouvrage.
Un « job à la con », pour David Graeber, c’est « une forme d’emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflue ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu’il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu’il n’en est rien. »
Des boulots prestigieux mais vides de sens
Contrairement aux « jobs de merde », payés à l’heure, exercés par des cols-bleus, ouvriers et autres exécutants, les « jobs à la con » sont occupés par des cols blancs. Ces salariés suscitent l’admiration, alors qu’au fond d’eux, ils sont malheureux au travail. D’après un sondage YouGov conduit au Royaume-Uni et cité par David Graeber, 37 % des personnes interrogées considèrent que leur emploi n’apporte rien au monde. Une autre étude menée aux Pays-Bas par l’institut Schouten & Nelissen donnait un résultat similaire (40 %).
Multiplication des réunions, de la paperasse, des couches hiérarchiques, des sous-traitants… Ce phénomène s’explique par de nombreux facteurs. Souvent associé au secteur public, il touche également les entreprises privées, explique David Graeber. C’est là tout le paradoxe : dans un monde capitaliste, qui se veut performant et efficace, des milliers d’employés ont l’impression de pédaler dans le vide.
Pour mieux illustrer son propos, l’auteur s’est appuyé sur les nombreux témoignages reçus et a distingué cinq catégories de « job à la con ».
- Les larbins
Pour David Graeber, ces salariés sont des domestiques modernes. Ils sont là pour « permettre à quelqu’un d’autre de paraître ou de se sentir important ». C’est le cas d’Ophelia, qui travaille dans le marketing. Elle est « coordinatrice de portefeuille », mais admet qu’elle n’a « aucune idée » de ce qu’elle est censée faire.
« En lui-même, mon titre renvoie clairement à un job à la con. Par contre, la réalité de mon boulot, c’est d’être l’assistante personnelle du directeur. Et là, j’ai vraiment de quoi faire, parce que les gens pour qui je travaille sont trop « débordés » ou trop importants pour faire toutes ces choses eux-mêmes. À vrai dire, la plupart du temps, j’ai l’impression d’être la seule personne à bosser dans le bureau. »
- Les porte-flingues
Ces employés exercent un métier qui « paraît dépourvu de toute valeur sociale positive », qu’ils « considèrent comme intrinsèquement manipulateur et agressif ».
Tom, par exemple, est employé par une grosse boîte de postproduction américaine. Il travaille pour des studios de cinéma, ce qui lui plaît, mais aussi pour des agences de communication. C’est là que le bât blesse.
Une partie de son travail consiste à effacer les imperfections des acteurs des spots publicitaires : il blanchit des dents, amincit les silhouettes, ajoute des reflets sur les cheveux… « Ces techniques sont utilisées dans tous les spots télévisés, mais aussi dans la plupart des fictions télé et de nombreux films. Autant sur les actrices que sur les acteurs. Pour résumer, on essaie de donner aux spectateurs qui regardent ces programmes le sentiment qu’ils ne sont pas à la hauteur, et ensuite, pendant les pages de pub, on exagère l’efficacité des « solutions qu’on prétend leur livrer. […] Mon travail, c’est ça : fabriquer de la demande en créant un manque et, parallèlement, survendre l’utilité des produits proposés pour combler ce manque. »
- Les rafistoleurs
Ces employés passent leur temps à régler des problèmes qui ne devraient pas exister. Ils rattrapent les bourdes de leur supérieur, comblent un manque d’organisation, ou exercent des tâches qui pourraient être automatisées. David Graeber donne cet exemple :
« Ma seule et unique fonction, c’était de surveiller la boîte de soutien technique. Ces demandes étaient rédigées dans un formulaire donné, et moi je devais les copier-coller dans un autre formulaire. Le pire, ce n’est pas que cette tâche aurait pu être automatisée, c’est qu’elle l’avait déjà été ! Simplement, à la suite d’un désaccord entre managers, ils avaient décrété une standardisation qui avait annulé l’automatisation. »
- Les cocheurs de case
Selon David Graeber, ces salariés permettent à une organisation de « prétendre faire quelque chose qu’en réalité elle ne fait pas ».
Il donne l’exemple de Betsy, employée pour s’occuper des activités de détente dans une maison de repos. « L’essentiel de mon travail consistait à interviewer les résidents afin de noter leurs préférences personnelles dans un « formulaire loisirs ». Ensuite, on rentrait ces données dans un ordinateur, après quoi on s’empressait de les oublier pour toujours. »
- Les petits chefs
David Graeber distingue deux sous-catégories. La première, c’est celle des petits chefs qui « assignent des tâches à d’autres », et dont le boulot peut s’avérer inutile si ses subalternes travaillent en autonomie. C’est le cas d’Alphonse : « Mon boulot consiste à encadrer et coordonner une équipe de cinq traducteurs. Le problème, c’est qu’ils sont formés à tous les outils dont ils ont besoin et savent très bien gérer leur temps et leurs missions. »
La seconde sous-catégorie, c’est celle des petits chefs qui « créent des tâches à la con pour les autres », comme l’explique Chloe. Cette doyenne d’une grande université britannique avait pour mission de proposer un « leadership stratégique ».
Elle travaillait avec trois personnes, mais comme elle n’avait aucun pouvoir décisionnel, ses propositions n’aboutissaient à rien : « Mon assistant de direction, un type brillant, n’a guère pu être davantage qu’un gestionnaire de planning hors pair. Quant à la postdoctorante, c’était un pur gaspillage de temps et d’argent. J’effectue mes recherches toute seule et je n’ai pas besoin d’un assistant J’ai donc passé deux ans de ma vie à m’inventer du travail, à moi-même et à d’autres. »
Chloe a ensuite accepté un poste de chef de département. Elle a démissionné au bout de six mois. Selon elle, c’est « l’idéologie managérialiste » qui crée ces postes absurdes. « À mesure qu’elle s’incruste, des pans de plus en plus vastes du personnel universitaire sont assignés à une seule et unique fonction : jongler avec la myriade de joujoux qu’elle invente – stratégies, objectifs de performance, audits, rapports, évaluations, nouvelles stratégies, etc. Le tout totalement déconnecté de ce qui devrait couler dans les veines de l’université : l’enseignement et l’éducation. »